|
EN BREF
|
Les agriculteurs, malgré leur volonté d’améliorer leur bilan carbone, se heurtent à des obstacles majeurs quant à l’absence de rémunération pour leurs efforts. Le secteur agricole québécois, qui représente 10 % des émissions de gaz à effet de serre, fait face à une pression croissante pour réduire ces émissions, mais les mécanismes d’incitation financière, tels que la prime verte, tardent à se concrétiser. De nombreux producteurs, ayant déjà mis en place des pratiques respectueuses du climat, restent dans l’attente d’une valorisation de leurs efforts, soulignant l’urgence d’un encadrement financier pour stimuler la transition écologique.
Alors que l’urgence climatique prend une ampleur considérable, les agriculteurs se retrouvent confrontés à des enjeux majeurs en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, la prime verte est devenue un élément essentiel pour les exploitations cherchant à améliorer leur bilan carbone. Malgré les efforts déployés, de nombreux agriculteurs attendent encore des compensations financières qui pourraient les aider à rendre leurs pratiques plus durables. Cet article explore la situation actuelle des agriculteurs québécois et les défis qu’ils rencontrent pour bénéficier des primes tant espérées.
Un secteur agricole à l’épreuve du climat
Le secteur de l’agriculture représente environ 10% des émissions de gaz à effet de serre au Québec, un chiffre qui peut sembler minime en comparaison avec d’autres industries, mais qui englobe néanmoins un potentiel de réduction des GES considérable. Les agriculteurs, qui sont souvent en première ligne des impacts du changement climatique, sont également les principaux acteurs du changement nécessaire pour rectifier le tir. Ils travaillent sans relâche pour améliorer leurs pratiques et réduire les emissions, mais se heurtent à des obstacles financiers importants.
Les enjeux de la monétisation des efforts
Un producteur de porcs, Christian Grenier, témoigne de l’urgence de la situation : « Vu l’urgence climatique, il faut rapidement arrêter d’envoyer du carbone dans l’air et plutôt le stocker dans le sol ». Il souligne que même les agriculteurs les plus engagés dans l’amélioration de leur bilan carbone ont du mal à voir leur travail récompensé financièrement. En effet, le système actuel du marché agroalimentaire ne parvient pas à valoriser les efforts de réduction des émissions, laissant beaucoup dans l’incertitude quant à leur retour sur investissement.
Une demande insatisfaite
Des initiatives sont mises en œuvre pour calculer les bilan carbone et offrir des solutions d’amélioration, mais les paiements incitatifs font encore défaut. Maude Fournier-Farley, de Sollio Agriculture, note que « c’est encore très peu encadré, sinon pas encadré du tout ». Face à cette situation, les agriculteurs se trouvent dans une position précaire et fragilisée, incertains de pouvoir tirer profit de leurs efforts pour l’environnement.
Un besoin urgent de restructuration
Pour que le secteur agricole puisse réduire ses émissions de GES, il devient impératif de trouver un cadre réglementaire qui favorise cette tendance. En effet, les émissions du secteur agricole au Québec stagnent depuis plus de vingt ans. Cela soulève des questions concernant la nécessité d’un nouveau modèle d’affaires qui pourrait permettre aux agriculteurs de profiter des gains réalisés à travers la réduction des émissions.
Les trois grands contributeurs aux émissions
Les trois grandes sources d’émission dans le secteur de l’agriculture sont la digestion des animaux, la gestion des fumiers et la gestion des sols. Chacune de ces composantes représente un défi spécifique et nécessite des solutions variées. Les agriculteurs doivent non seulement être soutenus financièrement, mais aussi recevoir des outils adaptés à leur situation pour pouvoir répondre efficacement à ces défis.
Les solutions à envisager
Dans la lutte contre les changements climatiques, deux solutions majeures se distinguent : la réduction des émissions de GES et la séquestration de carbone dans le sol. La première offre des résultats plus rapides tandis que la seconde génère des bénéfices supplémentaires, comme un enrichissement des sols, ce qui est bénéfique pour la productivité agricole. Marie-Élise Samson, professeure à l’Université Laval, rappelle que « un sol riche en carbone est généralement un sol en bonne santé chimique, physique et biologique », soulignant l’importance de la séquestration dans la viabilité à long terme des pratiques agricoles.
La stratégie gouvernementale et ses effets
Le gouvernement du Québec vise des objectifs de réduction moins ambitieux pour le secteur agricole par rapport à d’autres secteurs de l’économie. La cible de 5% de réduction des émissions des sols cultivés d’ici 2030, comparativement à 2017, peut paraître modeste face aux efforts globaux nécessaires. Les agriculteurs devront faire face à une pression accrue, notamment de la part des transformateurs qui cherchent à intégrer des objectifs stricts tout au long de leur chaîne de valeur.
Des acheteurs encore silencieux
À mesure que l’échéance de 2030 approche, les agriculteurs disent ne pas ressentir encore cette pression sur le terrain. Des producteurs comme Pascal Viens, qui travaille sur son bilan carbone depuis plusieurs années, se sentent laissés pour compte, car leurs acheteurs ne leur versent pas encore de prime verte pour leur lait. Pourtant, il croit fermement que cela changera, et le besoin de communication de la part de l’industrie agroalimentaire est essentiel pour faire valoir cette nécessité auprès des producteurs.
Développer des modèles d’affaires durables
Des entreprises comme Sollio Agriculture tentent de développer des modèles d’affaires pour intégrer les pratiques agricoles sobres en carbone. En 2022, Sollio a lancé le projet AgroCarbone Grandes Cultures en collaboration avec la firme Coop Carbone. L’initiative vise à établir des procédures qui faciliteront à la fois la réduction des émissions par les agriculteurs et leur capacité à recevoir des compensations financières pour ces efforts.
Créer des crédits carbone
Les producteurs doivent choisir s’ils souhaitent créer des crédits carbone pour de tierces parties (compensation sur le marché volontaire) ou les garder pour les entreprises agroalimentaires qui achètent leurs produits (insetting). Les modèles d’affaires proposés par AgroCarbone mettent l’accent sur l’adaptabilité et la flexibilité, garantissant que chaque agriculteur puisse trouver une solution adéquate pour sa réalité économique.
À la recherche de financement public pour l’avenir
Les efforts de compensation des agricultures nécessitent également un soutien public. Sollio Agriculture et la Coop Carbone travaillent activement à obtenir des financements fédéraux pour les agriculteurs désireux de vendre des crédits compensatoires via le système de tarification du carbone. Une aide financière de 2 millions de dollars a été demandée à Environnement et Changement climatique Canada, avec l’espoir que cela puisse contribuer à dédommager les producteurs pour leurs efforts.
Les défis d’une transition à coût nul
Au Canada, le secteur agricole est souvent exclu des systèmes de tarification du carbone industriel, sauf par le biais des carburants consommés. Pourtant, les agriculteurs ont la possibilité de créer des crédits carbone pour compenser les émissions d’autres secteurs industriels. En effet, des pratiques agricoles variées peuvent permettre aux producteurs de ne pas supporter de coûts supplémentaires, tout en améliorant leur bilan carbone.
L’avenir des agriculteurs face aux attentes croissantes
Malgré un climat de réformes et d’espoir, les agriculteurs restent inquiets. Alors que les agriculteurs cherchent à répondre aux attentes croissantes en matière de durabilité, ils ont besoin de mesures et de structures incitatives solides pour pouvoir agir. Sans un soutien financier adéquat, leurs efforts pour améliorer leur bilan carbone risquent de rester lettre morte.
Le temps de l’action est désormais
Les agriculteurs comme Pascal Viens, qui modifient progressivement leurs pratiques pour devenir plus durables, gardent un certain optimisme. Mais ce changement doit être encouragé par des mesures concrètes de la part des institutions et des acheteurs finaux. Une transition réussie pourrait permettre à l’agriculture non seulement de se conformer aux exigences environnementales, mais aussi de prospérer dans un marché de plus en plus compétitif et sensible à l’environnement.
Vers une agriculture plus durable et rémunératrice
Les initiatives envers la transition écologique devront être accompagné d’un cadre réglementaire clair qui valorise les efforts des agriculteurs. Les agriculteurs sont une ressource précieuse dans la lutte contre le changement climatique, et il est impératif qu’ils soient soutenus dans leurs efforts visant un bilan carbone amélioré. Cela inclut la mise en place de primes vertes justes et accessibles, ainsi que la reconnaissance pleine de leur rôle dans la protection de l’environnement.
Conclusion : le rôle des citoyens et des décideurs
Pour les agriculteurs, répondre aux attentes en matière de durabilité et de réduction des émissions nécessitera la synergie entre les producteurs, les décideurs, et les citoyens. Un engagement collectif est nécessaire pour faire avancer la transition vers une agriculture durable et adaptée aux défis climatiques auxquels nous faisons face aujourd’hui.

Témoignages d’agriculteurs en attente de leur prime verte
Christian Grenier, producteur de porcs de L’Ange-Gardien, témoigne des défis qu’il rencontre. « Vu l’urgence climatique, il faut rapidement arrêter d’envoyer du carbone dans l’air et plutôt le stocker dans le sol. Malheureusement, même avec mes efforts pour réduire les émissions de GES, cela ne se traduit pas encore en revenus concrets. Je peine à comprendre pourquoi mes efforts ne sont pas valorisés dans le système agroalimentaire actuel. »
Pascal Viens, exploitant d’une ferme laitière en Estrie, partage son ressenti : « Je travaille depuis plusieurs années à améliorer mon bilan carbone, mais mes acheteurs ne me compensent pas encore pour cela. Je suis convaincu qu’un jour, la situation changera et que mon engagement sera reconnu. En attendant, je reste en attente de cette fameuse prime verte. »
Pour Renaud Péloquin, producteur de grandes cultures en Montérégie, la situation est frustrante : « Je m’efforce de réduire mes émissions de GES et d’améliorer la santé de ma terre, mais je ne vois pas encore de retour financier. L’industrie agroalimentaire ne semble pas avoir envoyé de message clair aux producteurs pour nous encourager financièrement dans cette transition. »
Maude Fournier-Farley, directrice chez Sollio Agriculture, souligne : « Des initiatives voient le jour, mais les paiements incitatifs restent trop rares. Les producteurs comme Christian, Pascal et Renaud attendent toujours une reconnaissance concrète pour leurs efforts. La situation actuelle rend difficile la transition vers des pratiques plus durables. »
Marie-Élise Samson, professeure en science des sols, indique que « pour 2030, la province vise une réduction des émissions, mais cela n’est pas encore répercuté sur le plan économique pour les agriculteurs. Ils ont besoin de ces primes pour pouvoir investir dans des pratiques agricoles durables. »

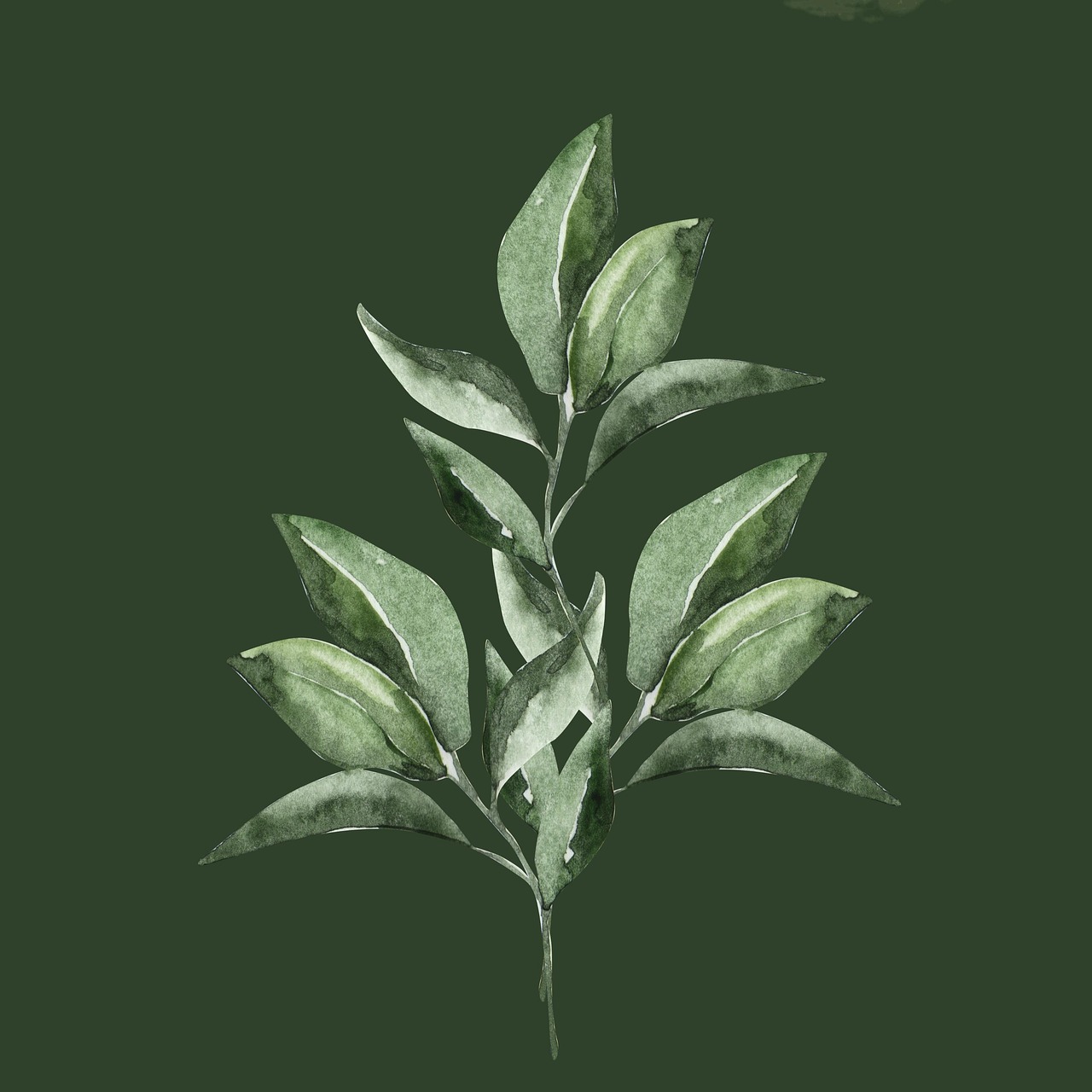

























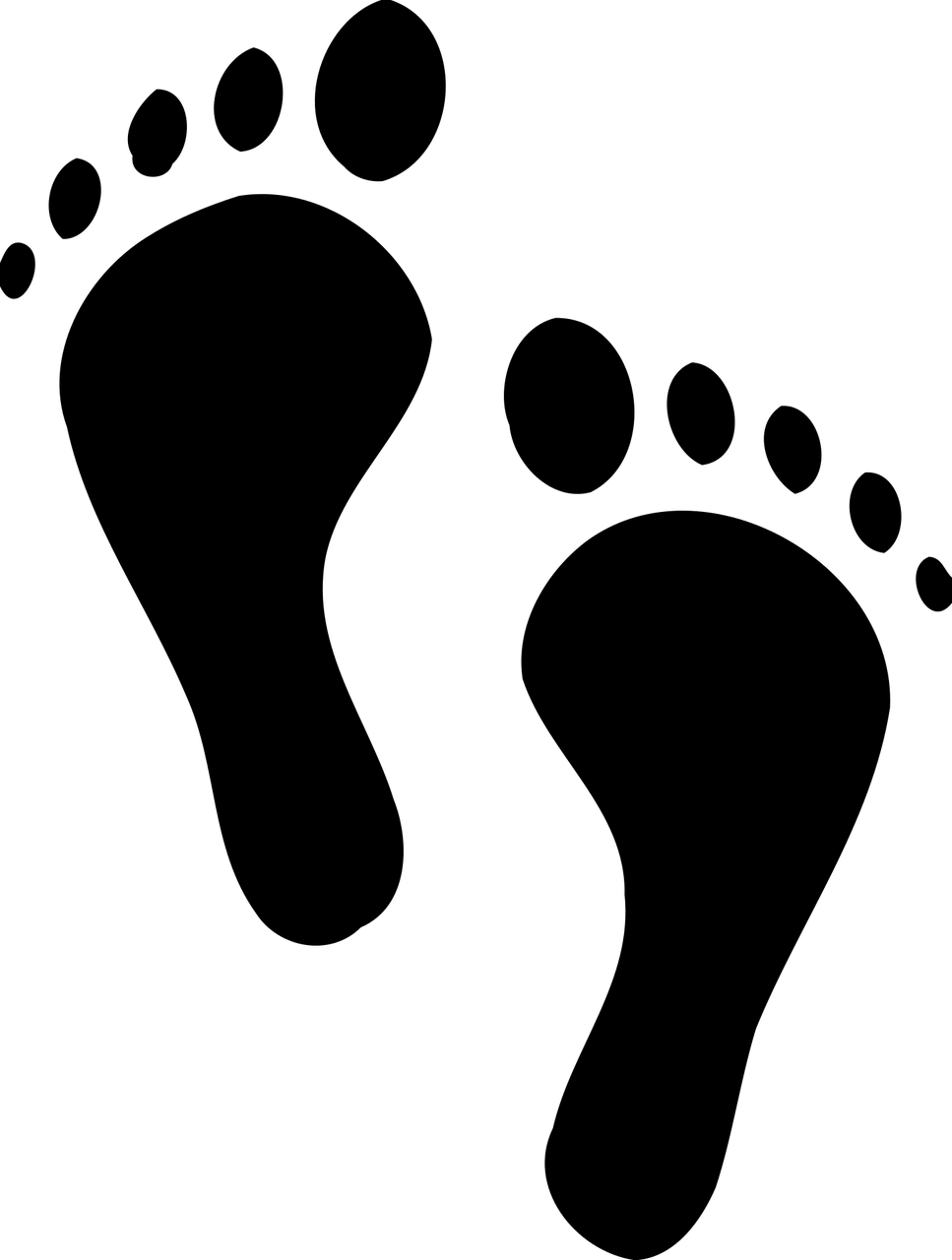
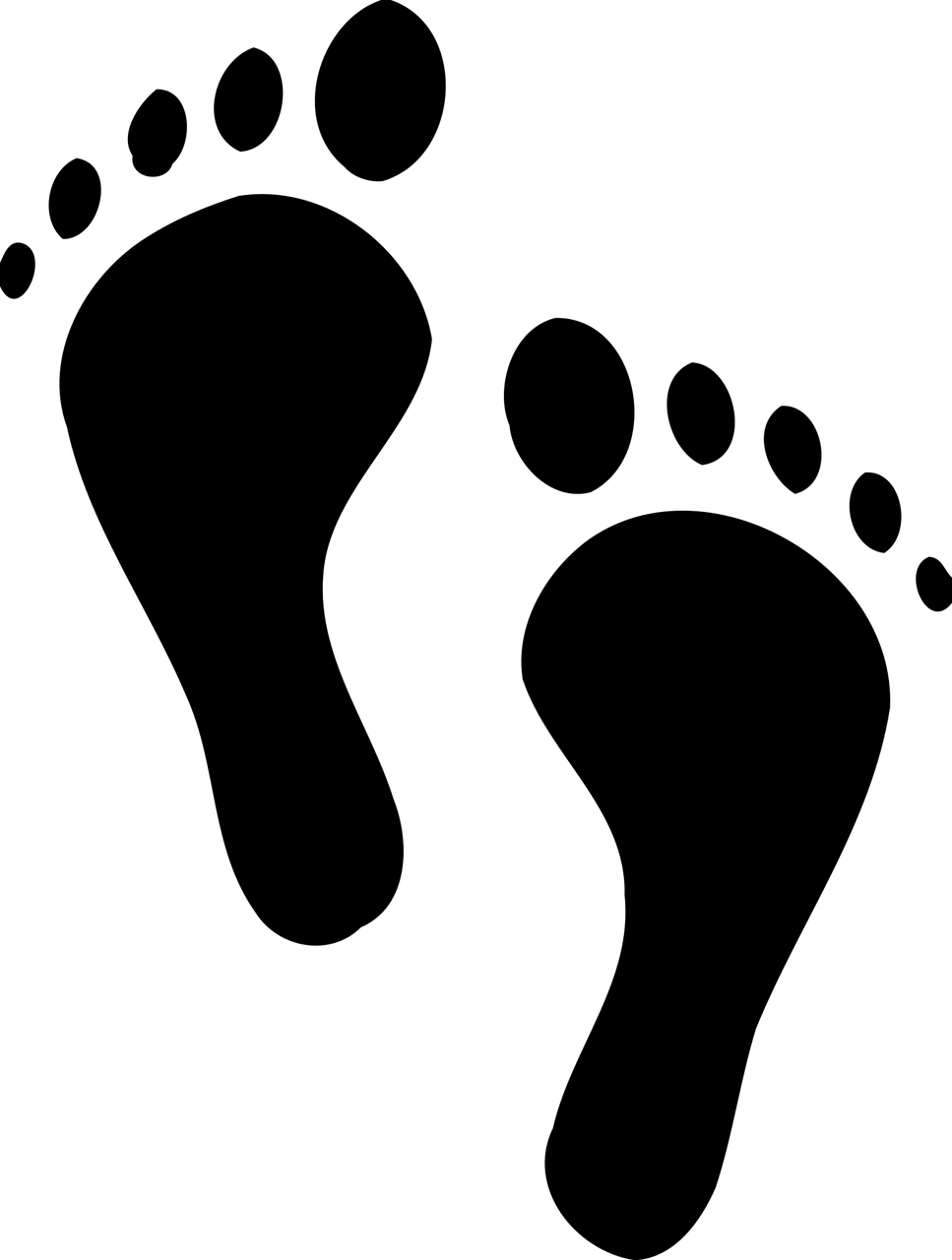






Leave a Reply